Les
transformations paysagères des espaces ruraux de l'ouest-Occitanie
Le paysage rural,
est, dans un milieu non urbain,
tel qu'il est perçu, le résultat
de l'interaction entre des éléments naturels, des modes de production et des aménagements.
C'est donc la représentation des relations que les hommes et les femmes
entretiennent avec leur milieu. Dans l'ouest de l'Occitanie, les éléments
entrant en jeu dans la définition des paysages sont nombreux et varient d’un
territoire à l’autre. Il en résulte une mosaïque
de paysages compartimentés.
Schéma
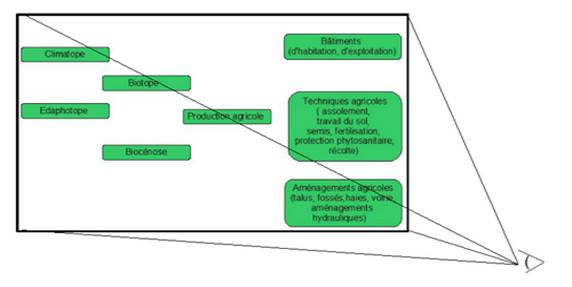
Comment évoluent les paysages ruraux de notre région ? Comment l'expliquer
?
I Des paysages traditionnellement
variés...
a) ...liés aux conditions naturelles
Les pratiques agricoles des montagnes diffèrent de celles des plaines. Ainsi dans les zones de montagne, en dépit
des progrès techniques, l’altitude et les conditions orographiques se
sont longtemps révélées déterminantes. Elles ont limité la mécanisation et la
mise en œuvre de productions agricoles intensives Ailleurs, dans les
plaines et les vallées, après avoir été longtemps polycole, l’agriculture de notre
région s'est spécialisée
dans, l’arboriculture
fruitière ( vergers des vallées du Tarn et de la Garonne) , les cultures maraîchères
, cultures céréalières, oléagineuses ou encore dans les productions de qualité.
Là les paysages ont été marqués par les pratiques. C'est ainsi par exemple que
les paysages
de champs ouverts plus ou moins barrés (openfields) se sont répandus
avec la politique de remembrement.
b )... et à l’évolution de l'agriculture.
Pour commencer, il y a moins d'actifs agricoles dans la région. Par exemple, dans la
région, entre 1970 et 2000, les effectifs d’actifs présents sur les
exploitations agricoles ont régressé de 58 %. Dans ces conditions, les exploitations agricoles ont été restructurées. On assiste
surtout à une concentration des
exploitations. La baisse du nombre d’actifs agricoles a été accompagnée par
une baisse du nombre des exploitations
et une augmentation de la taille moyenne
des restantes. Durant la décennie 1990, le nombre d’exploitations agricoles
a diminué de plus de 30 %.
L'agriculture a
également changé avec l'évolution de la politique agricole commune (PAC). Jusqu’au début des
années 80, l’objectif de la PAC était fut de faire de l’Europe une puissance
agricole capable de satisfaire ses besoins alimentaires grâce à des pratiques intensives. Dans les années
80, les limites de cette politique sont apparues. Elle s’est révélée coûteuse
pour le budget communautaire et les situations de surproduction se sont
multipliées. Désormais, l’objectif est désormais de mettre en place une agriculture aussi bien durable que
compétitive. Désormais les aides sont soumises à conditions.
Les agriculteurs sont de plus en plus intégrés dans des systèmes agro-industriels.
Nombreux sont en effet les agriculteurs qui travaillent dans le cadre de
coopératives ou sous contrat avec des industriels et/ou des distributeurs.
Pendant longtemps, l’intensification de la production
est allée de pair avec une mécanisation
et une chimisation
de l’agriculture. L’optimisation de la production passe aujourd’hui encore par l’irrigation. On observe également une tendance à la
spécialisation des exploitations agricoles. Les systèmes agricoles complexes
(polyculture) ont reculé. L'optimisation passe aussi par la valorisation de la qualité. De ce
point de vue, la région est la première en France pour le nombre de produits
bénéficiant d’une appellation
d’origine contrôlée (AOC), d’un label rouge ou d’une Appellation d’Origine Vin Délimité de
Qualité Supérieure (AOVDQS). Parmi les appellations, on peut
citer Roquefort à Millau et Saint-Affrique, vins à Cahors, Gaillac et Fronton,
raisins de table à Moissac, agneaux du Quercy à Figeac, haricots tarbais,
l’Armagnac dans le Gers.
L’agriculture biologique offre aussi une
alternative à la logique productiviste. L'Ouest-Occitanie est l’une des régions
de France où l’agriculture
biologique se développe rapidement.
Dans un contexte
difficile, la
survie de certaines exploitations est en effet parfois liée à la diversification des activités. Cela passe
par la proposition d'une offre
touristique (agrotourisme) par la
pratique de la vente directe ou la restauration.
II Les paysages ruraux de la région évoluent.
a) Les paysages
agricoles de la région restent marqués par l'activité agricole mais....
L’activité agricole
couvrent encore la majorité du
territoire
dans notre région . Même dans les campagnes proches de villes, les activités
agricoles continuent à valoriser le paysage.
b) ... ils se
transforment du fait de l'intensification et de la spécialisation des pratiques
agricoles ...
On voit se constituer actuellement des zones
géographiques spécialisées ( voir carte) . Dans ces secteurs,
le risque est de voir le paysage
s’uniformiser par la généralisation de cultures et la diffusion de pratiques
spécifiques. Les paysages se couvrent alors des mêmes cultures, des mêmes
types de bâtiments agricoles.
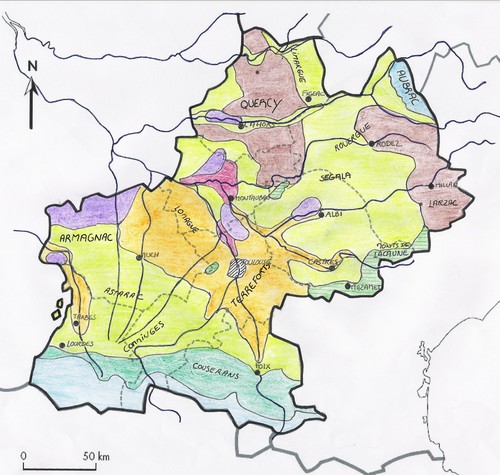
![]() Paysages agraires des hautes
montagnes. Ils sont marqués par l’étagement et par l’opposition ente adret et
ubac. Les conditions d’exploitation limitent les pratiques agricoles. Les
estives permettent l’existence d’un pastoralisme le plus souvent ovin dans une
logique extensive. Le forêt est également très présente et tend à s’étendre.
Paysages agraires des hautes
montagnes. Ils sont marqués par l’étagement et par l’opposition ente adret et
ubac. Les conditions d’exploitation limitent les pratiques agricoles. Les
estives permettent l’existence d’un pastoralisme le plus souvent ovin dans une
logique extensive. Le forêt est également très présente et tend à s’étendre.
![]() Paysages agraires de
moyenne montagne. C’est le domaine des prairies et de l’élevage. Ces moyennes
montagnes sont également des espaces très boisés.
Paysages agraires de
moyenne montagne. C’est le domaine des prairies et de l’élevage. Ces moyennes
montagnes sont également des espaces très boisés.
![]() Autres espaces très
boisés.
Autres espaces très
boisés.
![]() Paysages agraires des
Causses. A l’exception de certaines dépressions consacrées aux cultures, les
plateaux sont pour l’essentiel des espaces de pâturage pour l’élevage ovin. Ils
peuvent cependant par endroits, être très boisés comme dans le Haut-Quercy
Paysages agraires des
Causses. A l’exception de certaines dépressions consacrées aux cultures, les
plateaux sont pour l’essentiel des espaces de pâturage pour l’élevage ovin. Ils
peuvent cependant par endroits, être très boisés comme dans le Haut-Quercy
![]() Paysages agraires des
régions de collines et de coteaux de Midi Pyrénées. Les champs de céréales ou
d’oléagineux côtoient les prairies artificielles destinées à l’élevage bovin.
Ca et là, des bâtiments d’exploitation témoignent de la présence d’élevages porcins
ou avicoles. C’est le domaine du bocage, des coteaux ou des gorges boisés.
Paysages agraires des
régions de collines et de coteaux de Midi Pyrénées. Les champs de céréales ou
d’oléagineux côtoient les prairies artificielles destinées à l’élevage bovin.
Ca et là, des bâtiments d’exploitation témoignent de la présence d’élevages porcins
ou avicoles. C’est le domaine du bocage, des coteaux ou des gorges boisés.
![]() Paysages agraires des
vignobles de Midi-Pyrénées. Dans ces zones, il est rare que la vigne occupe
l’ensemble des surfaces. Elle rythme cependant le paysage de ses rangées et de
ses changements de couleurs saisonniers.
Paysages agraires des
vignobles de Midi-Pyrénées. Dans ces zones, il est rare que la vigne occupe
l’ensemble des surfaces. Elle rythme cependant le paysage de ses rangées et de
ses changements de couleurs saisonniers.
![]() Paysages agraires des
zones de spécialisations arboricoles et maraîchères. Le paysage est marqué par
les vergers, et les productions de légumes en plein champs ou sous serres.
Paysages agraires des
zones de spécialisations arboricoles et maraîchères. Le paysage est marqué par
les vergers, et les productions de légumes en plein champs ou sous serres.
![]() Paysages agraires des
zones de grandes cultures. C’est le domaine des cultures industrielles souvent
irriguées. Les conséquences du remembrement et de l’intensification de la
production s’y observent. Ces paysages caractérisent les grandes vallées mais
aussi les régions où le modelé des collines ne constitue pas un obstacle majeur
à la mécanisation.
Paysages agraires des
zones de grandes cultures. C’est le domaine des cultures industrielles souvent
irriguées. Les conséquences du remembrement et de l’intensification de la
production s’y observent. Ces paysages caractérisent les grandes vallées mais
aussi les régions où le modelé des collines ne constitue pas un obstacle majeur
à la mécanisation.
b) ....de la
déprise agricole
La baisse de la population agricole peut se
traduire par endroits par une progression des broussailles, des friches, des
landes des forêts. On parle alors de déprise agricole. Elle est à
l'œuvre l’œuvre dans les Causses, en
Ariège et dans les Hautes-Pyrénées. Elle peut provoquer une « fermeture du paysage ».
c) ...de l'urbanisation
Dans la périphérie des agglomérations et le
long des grands axes, on assiste à des processus d’artificialisation des
paysages. Avec l’urbanisation et le développement des transports, les
constructions et les infrastructures se multiplient. Parmi les bassins de vie ruraux
où les surfaces destinées à l’agriculture régressent rapidement, on peut citer
l'ouest toulousain jusqu'aux Portes de
Gascogne.
d) De l’évolution
des orientations économiques des bassins de vie ruraux.
Certaines campagnes de la région ont tendance
à devenir des espaces résidentiels et/ou
récréatifs. Des résidences principales ou secondaires sont restaurées ou
bâties provoquant parfois un mitage
des campagnes par un nouvel habitat
pavillonnaire. Désormais, les usages
comme la randonnée, la chasse, et différentes cueillettes ( champignons,
asperges sauvages) distinguent de moins en moins les ruraux des citadins de
passage ou nouvellement établis. Cela n’empêche pas cependant le développement
des conflits d’usages. La vocation touristique se développe
également dans le rural, en particulier dans les Pyrénées ou aux abords des
sites au patrimoine naturel ou architectural remarquable.
III Typologie des
paysages ruraux.
Compte tenu du sujet il est possible de
classer les espaces agricoles de notre région en fonction de trois
critères : la place de
l’agriculture dans l’économie, son impact
dans le paysage, la proximité de la
ville et de son influence.
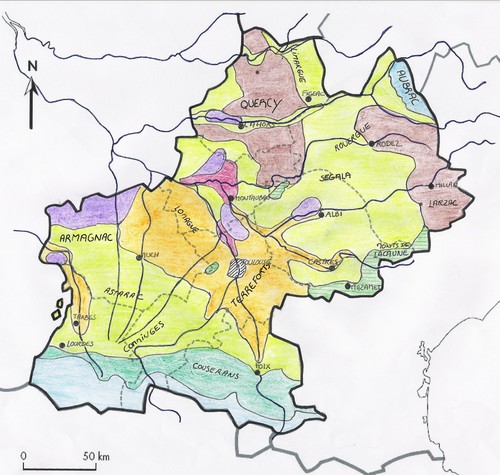
![]() Campagnes à
productions de qualité à forte valorisation du territoire et du paysage.
Campagnes à
productions de qualité à forte valorisation du territoire et du paysage.
Dans ces campagnes domine la polyproduction. Certaines spécialités remarquables font l’objet
d’une valorisation particulière grâce à des signes officiels de qualité. Les
paysages agraires traditionnels sont souvent mis en avant pour les promouvoir.
Des activités de tourisme et d’agrotourisme (hébergement, restauration) se
développent.
![]() Campagnes à
agricultures intensives et compétitives où le paysage peut être menacé.
Campagnes à
agricultures intensives et compétitives où le paysage peut être menacé.
Il s’agit des campagnes où dominent les
cultures industrielles, les cultures fruitières et maraîchères. Dans ces
campagnes, l’intensification passe souvent par le développement de
l’irrigation. Le paysage témoigne des aménagements hydrauliques plus ou moins
importants réalisés à cet effet. Ces campagnes ont parfois tendance à
s’uniformiser. On retrouve les mêmes cultures les mêmes bâtiments agricoles,
les mêmes techniques de production. Ces campagnes sont particulièrement
exposées à l’urbanisation et à l’artificialisation liée à la réalisation de
grandes infrastructures.
![]() Pôles urbains
Pôles urbains
![]() Les campagnes
périurbaines fortement artificialisées mais de façon incomplète.
Les campagnes
périurbaines fortement artificialisées mais de façon incomplète.
Dans le rural périurbain, la population
active agricole est très minoritaire. L’artificialisation du paysage progresse
du fait de l’extension du bâti et du développement des voies de communication.
Cependant, l’agriculture résiduelle contribue à créer des aménités paysagères
qui font de ces campagnes proches des villes des espaces toujours attractifs.
![]() Les campagnes
intermédiaires.
Les campagnes
intermédiaires.
Dans ces campagnes, les densités de
populations sont faibles. L’activité agricole recule même si elle occupe encore
une part relativement importante de la population active. Ces campagnes sont
moins attractives d’un point de vue touristique mais leurs fonctions
résidentielles se développent.
![]() Les campagnes à
agriculture résiduelle revalorisée dans le cadre de la gestion du patrimoine
paysager et naturel.
Les campagnes à
agriculture résiduelle revalorisée dans le cadre de la gestion du patrimoine
paysager et naturel.
Ces campagnes correspondent le plus souvent à
des terres difficiles à cultiver pour différentes raisons ( pente, maigreur des
sols). Elles connaissent aujourd’hui un processus de déprise agricole
caractérisé par une progression de la forêt et des friches. Dans ces campagnes
cependant, l’agriculture contribue souvent à la prévention des risques
naturels, à l’attractivité des espaces sur le plan touristique et à l’entretien
du paysage. Elle s’inscrit souvent dans le périmètre d’un parc naturel.
Conclusion :
Dans notre région comme ailleurs dans le monde,
l'influence croissante des villes, la diminution du nombre
d'agriculteurs, l'évolution des pratiques agricoles, l'apparition de nouvelles
fonctions et l'arrivée de nouvelles populations provoquent une transformation
des espaces ruraux et des paysages qui les caractérisent. Ils étaient variés
depuis longtemps . Cette diversité se confirme mais autrement.
Vocabulaire :
Agrosystème : ensemble constitué par le milieu, les cultures,
les techniques de production agricole et leurs interactions.
Agriculture
biologique : le décret du 10 mars 1981 la définit comme étant une «
agriculture n’utilisant pas de produits chimiques de synthèse ».
Appellation
d’origine contrôlée : les AOC donnent des garanties en matières
de terroir, de savoir-faire et d’ origine géographique.
Artificialisation :
progression des constructions et des infrastructures dans le paysage.
Bassins
de vie : le bassin de vie est un territoire structuré autour
d’un pôle urbain ou rural. Sur ce territoire, les habitants ont accès à
l’emploi et aux équipements (concurrentiels ou non concurrentiels). Les bassin
de vie participent à la hiérarchisation et à l’organisation des territoires.
Biotope :
éléments non vivants de l’écosystème comprenant le climat et le sol.
Biocénose
:
association d’animaux et de végétaux dans un écosystème donné.
Bocage :
espace où les parcelles agricoles sont closes par des haies d’arbres et
d’arbustes. La haie est champêtre lorsqu’elle est constituée d’essences
différentes. On parle sinon de haie mono-spécifique.
Déprise
agricole : réduction marquée de l’activité agricole se
manifestant souvent par un dépeuplement, un recul de la superficie utilisée par
les exploitations agricoles, par une progression des friches et de la forêt.
Economie
résidentielle : Elle regroupe les activités destinées à
satisfaire les besoins des populations locales [INSEE]
Estive :
pâturage d’été en haute montagne.
Jachère :
terre labourée laissée au repos. [INSEE]
Mitage
:
forme d’urbanisation qui se caractérise par l’apparition de lotissements ou par
la dispersion de maisons neuves isolées dans les campagnes.
Pastoralisme :
pratique de l’élevage nomade. En Midi-Pyrénées, les élevages relèvent en
général d’une exploitation sédentaire mais, l’été venu, ils gagnent les terres
de haute montagne faiblement productives : les estives.
Polyculture :
terme pouvant désigner l’association de plusieurs activités agricoles sur une
exploitation ou la coexistence à l’échelle locale d’exploitations spécialisées
dans des domaines différents.
Remembrement :
pratique consistant à modifier le parcellaire et à réduire le morcellement par
un regroupement et un échange de terres entre les divers propriétaires et
exploitants. Ce processus vise à la simplification des conditions
d’exploitation et à une amélioration agricole ou d’utilisation spatiale.
Soulane :
terme d’origine occitane désignant le versant de la montagne exposé au soleil.
Système
agro-industriel : système dans lequel l’ agriculteur est lié
souvent par contrat à des structures commercialisant la production et
fournissant une partie du matériel, des intrants.
Terroir :
portion d’espace agricole homogène ayant des caractéristiques agronomiques
particulières susceptibles de donner aux produits agricoles des qualités
spécifiques.
Auteur :
Nérée Manuel